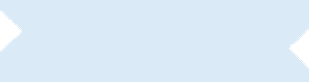Written by Yann AlixArticle No. 21 [UNCTAD Transport and Trade Facilitation Newsletter N°78 - Second Quarter 2018]
Déficience persistante de connectivité globale
L’Afrique représente un cinquième des terres émergées planétaires pour à peine un sixième de la population totale. Les 1,2 milliards d’habitants répartis en 54 pays s’imposent comme un formidable réservoir de croissance mais géographiquement dispersé, logistiquement mal connecté et économiquement défavorisé par des surcoûts de transport et de transaction parmi les plus élevés au monde.
Il en résulte que l’on compte en 2017 moins de 20 conteneurs manutentionnés pour 1,000 habitants africains contre près de 150 pour 1000 habitants de l’Union européenne.
Dans un univers marchand structuré par les échanges maritimes internationaux, le conteneur fait office d’indicateur de maturité macro-économique, se révélant comme un marqueur de l’attractivité logistique d’une région ou même d’un continent.
Le déficit de connectivité maritime de la plupart des nations africaines (UNCTAD, 2017) confirme cette réalité avec un profil dichotomique du continent caractérisé par un déséquilibre persistant entre les volumétries conteneurisées importées et exportées.

Le trop faible niveau d’industrialisation, l’insuffisante transformation des productions continentales et la prédominance de l’exportation en vrac des ressources minières et énergétiques expliquent la présente situation.
Révolution portuaire du Millenium africain
Les années 2000 marquent un tournant pour les systèmes de transport du continent. Après un demi-siècle post-colonial de sous-investissements publics, la modernisation des interfaces portuaires s’enclenche sous l’impulsion des réformes du FMI et de la Banque Mondiale. Sur la dernière décennie 2007-2017, le transfert de compétences et de responsabilités des activités de gestion et de manutention des terminaux conteneurisés a généré des investissements de 50 milliards US$ de la part des Etats, des bailleurs de fonds internationaux et bien sûr d’opérateurs privés spécialisés.
Cette libéralisation du segment clé du conteneur a fait émerger des spécialistes continentaux privés comme le groupe Bolloré. Depuis la concession du terminal SETV à Abidjan en 2004, pas moins de 15 autres terminaux africains sont passés sous son contrôle. Même logique d’expansion pour le spécialiste APM Terminals du groupe danois AP-Moeller qui dispose de connectivités maritimes privilégiées avec l’armement Maersk Line, leader mondial et porte-étendard du groupe. Bolloré et APM Terminals travaillent de surcroit de concert sur des terminaux à fort potentiel comme à Téma au Ghana ou à Lagos au Nigéria. Autre exemple remarquable, l’engagement en une décennie du 4ème opérateur mondial DP World sur toutes les façades portuaires du continent, de l’Algérie au Mozambique, du Sénégal au futur port géant de Banana en RDC ou celui de l’île de Suakin dans les eaux soudanaises.
De la concentration de services transcontinentaux sur trois grands hubs portuaires africains...
De cette stimulation concurrentielle résulte une cartographie portuaire africaine marquée par trois dimensions principales :
L’émergence de services transcontinentaux sur trois grands hubs internationaux africains qui concentrent les trafics continentaux par leur position géostratégique aux carrefours des plus importantes routes maritimes. Tanger Med sur le Détroit de Gibraltar, Port-Saïd à l’embouchure du Canal de Suez et Durban, à la rencontre des Afriques Australes constituent les trois arêtes portuaires du triangle Afrique. Durban structure depuis 25 ans maintenant la hiérarchie portuaire du « cône sud » avec l’articulation des flux asiatiques, du sous-continent indien et de l’Afrique méridionale. Port Saïd, 3 millions d’Équivalent vingt pieds (EVP)en 2017, s’impose comme un vrai carrefour de la Méditerranée orientale, faisant de l’établissement égyptien un point névralgique d’agrégation et d’éclatement de flux sous-régionaux africains. Enfin, Tanger Med fait figure de « port pivot » de dernière génération, exploitant la convergence des routes maritimes les plus achalandées de la planète. Tanger Med sert de « porte d’entrée » de l’Afrique de l’Ouest tout en drainant les flux maghrébins et sud-européens pour s’imposer comme le premier port africain avec 3,3 millions d’EVP en 2017.
La consolidation de hubs régionaux, combinant les opportunités du marché domestique avec les connectivités logistiques vers des marchés enclavés ou voisins. Abidjan, Pointe-Noire, Mombasa ou encore Dar-es-Salaam disposent de terminaux modernes à forts tirants d’eau où se rejoignent, au cœur des marchés africains, des services directs avec l’Europe d’une part et l’Asie d’autre part. Abidjan reste le hub du Golfe de Guinée malgré une concurrence exacerbée de son voisin ghanéen Téma. Servant une économie ivoirienne étonnante de résilience, Abidjan entretient des relations logistiques privilégiées avec les marchés sahéliens. Pointe-Noire fait aussi office de point névralgique de l’Afrique centrale. En attendant l’hypothétique port en eau profonde de Banana, Pointe-Noire continue de servir de porte d’entrée de l’immense voisin RDC avec Kinshasa et ses 10 millions d’habitants. Sur la côte orientale, Mombasa et Dar-es-Salaam, outre le poids singulier de leur économie nationale respective, se disputent la desserte des Grands-Lacs et de l’est de la RDC via de lourds investissements terrestres afin de fiabiliser les pré et post-acheminements. Ils servent aussi de connecteurs avec hubs insulaires de Port-Louis et de Port-Réunion dans l’Océan indien.
La nouvelle génération d’infrastructures portuaires avec Lekki le Nigérian, Kribi le Camerounais… et de manière plus prospective, Suakin le Soudanais, Bagamoyo le Tanzanien ou même Techobanine le Mozambicain. Tous ces terminaux géants ont pour ambition de « régionaliser la globalisation des échanges avec l’Afrique ». Ils seront directement en compétition avec les deux premières dimensions portuaires en jouant la carte d’une plus grande proximité avec les marchés émergents via des corridors multimodaux de transport. Ces nouvelles terminaisons portuaires se projettent au cœur du continent via des structurations infrastructurelles planifiées. Routes, chemins de fer, réseaux de ports-secs, zones franches : les terminaux ne se déconnectent pas de l’enjeu vital de l’aménagement des territoires non-côtiers. Ces continuums logistiques pourraient changer l’insertion des marchés intérieurs dans les chaines de valeur africaines et mondiales ; tout en apportant une partie de la solution à la saturation très couteuse des métropoles portuaires actuelles. Dans le contexte de très forte croissance démographique unique à l’Afrique, cette nouvelle génération de port prend tout son sens.
… au SMART PORT MADE IN AFRICA
Les pouvoirs de décision et de négociation de l’autorité portuaire publique ne cessent de s’éroder face à la concentration et la massification des armements maritimes, des manutentionnaires globaux ou encore des intégrateurs logistiques. Il n’est pas inutile de rappeler qu’en 2017, le TOP 3 des armements maritimes contrôlent 50% des capacités mondiales, que le TOP 3 des manutentionnaires cumulent 250 millions d’EVP et que le TOP 3 des intégrateurs logistiques génèrent près de 75 milliards de revenus !
Dans ces nouveaux rapports concurrentiels, les autorités portuaires du continent et leur tutelle politique semblent bien mal armées pour défendre leurs intérêts souverains.
Avec des initiatives comme ChainPORT ou plus récemment MedPorts, certaines autorités portuaires innovantes semblent (enfin) prêtes à bousculer des cadres souverains et régaliens inadaptés aux réalités concurrentielles contemporaines. Sur le continent, sous l’égide de la Pan Africa Association for Port Cooperation, quelques autorités portuaires africaines continuent de se réunir tous les deux ans pour échanger leurs bonnes pratiques. Le Programme de Gestion Portuaires de la CNUCED TrainForTrade tient aussi ce rôle, notamment auprès des réseaux portuaires francophones et Anglophones actifs en Afrique. L’objectif de ce programme est de partager les connaissances et l’expertise entre opérateurs portuaires afin de renforcer la gestion des talents et le développement des ressources humaines des communautés portuaires.
Il convient d’aller beaucoup plus loin afin que l’Afrique portuaire ne manque pas ce nouveau virage stratégique majeur qui invite à réfléchir sur une nouvelle gouvernance. A moins que le positionnement symbolique d’un acteur privé ouest-européen comme Port of Antwerp International à la tête du Port Autonome de Cotonou au Bénin en 2017 ne soit d’ores et déjà une avancée stratégique pionnière dans la marchandisation inexorable de l’autorité portuaire »[i]. Deux grandes familles de pensées presque manichéennes s’opposent déjà sur le sujet avec :
D’une part, les défenseurs qui voient les opportunités de modernisation accélérée par des modalités de gestion optimisée et décorrélée des héritages hiératiques du passé ;
D’autre part, les pourfendeurs qui perçoivent les menaces de voir se diluer le contrôle du poumon économique national entre les mains d’une communauté d’affaires internationalisée.
Seul l’avenir nous le dira mais pour le moment, force est de constater qu’une grande part des autorités portuaires africaines ne s’inclut pas dans les réflexions sur les disruptions technologiques majeures liées au contrôle de l’information, aux innovations liées aux nouvelles énergies, aux enjeux du contrôle des filières par l’intelligence de marché, etc. Un Smart Port Made in Africa est tous sauf un copier-coller des initiatives actuelles du Port de Rotterdam en matière d’Internet des objets ou d’intelligence artificielle, du Port de Los Angeles en matière d’environnement ou encore des ports asiatiques sur de futurs cadres opérationnels de gouvernance partagée.
Coopération et compétition doivent être stimulées pour accompagner les réformes politiques indispensables à la modernisation des pratiques d’innovation et d’investissement de la part des autorités portuaires. Un important travail entre communautés portuaires africaines doit apporter des solutions africaines aux enjeux de la décongestion des métropoles, à l’absorption optimisée d’un potentiel doublement des trafics, à la réduction des pratiques informelles ou encore à la fluidification des logistiques des circulations intérieures. En réseaux d’intérêts, les autorités portuaires doivent anticiper les potentiels avérés de la croisière, l’accueil de navires propulsés au LNG ou encore l’optimisation capitalistique du denier public investi dans les infrastructures du domaine portuaire. Un réseau des Smart Port Africain doit produire des « boites à outils » de l’innovation portuaire africaine en fournissant les clés indispensables de la conduite du changement. On le constate déjà : l’implantation de Port Community Systems (PCS) au sein des communautés portuaires africaines ne se couronne de succès que par la formation, la sensibilisation et l’implication de toutes les parties prenantes. Un Smart Port africain doit imposer une légitimité de chef d’orchestre, au cœur d’une mutualisation d’intérêts publics et privés. Il en va de la valorisation économique et sociétale du dividende démographique africaine puisque les futurs 2 milliards d’habitants de 2050 devront eux-mêmes se projeter dans une Afrique qui n’occupera certainement plus la même place qu’aujourd’hui dans les chaînes de valeur internationales.
L’auteur, Dr. Yann Alix, est Délégué Général, a la Fondation SEFACIL basée à Le Havre (France).
Pour plus d’information, veuillez le contacter via Yann.alix@sefacil.com ou https://www.linkedin.com/in/yannalix/ ou https://twitter.com/Yann_Sefacil
[i]Yann Alix, 201 6, Histoires courtes maritimes et portuaires. D’Afrique et d’ailleurs. Editions EMS. Caen. Octobre 2016. 128p.