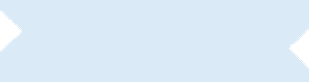Les gouvernements africains ont engagé de vastes efforts pour réduire les obstacles au commerce entre les pays du continent, mais parallèlement, ils doivent prendre de vigoureuses mesures pour stimuler leur secteur privé, indique Le Rapport 2013 sur le développement économique en Afrique1 Commerce intra-africain: Libérer le dynamisme du secteur privé, rendu public aujourd’hui. Faute de quoi ce sont des entreprises étrangères davantage que les entreprises africaines qui bénéficieront de cette rationalisation du système commercial, prévient la CNUCED.
La CNUCED salue la décision prise en janvier 2012 par les dirigeants africains d’éliminer les obstacles au commerce intra-africain afin de dynamiser le commerce régional.
Elle souligne la nécessité d’une telle approche en raison des tendances observées ces dernières années, à savoir que la part du commerce intra-africain dans le commerce africain total est passée de 22,4 % en 1997 à 11,3 % en 2011. Le commerce intra africain (exportations et importations) s’est élevé à 130,1 milliards de dollars des États-Unis en 2011. Ces chiffres sont sans doute en dessous de la réalité, étant donné l’importance des échanges commerciaux informels sur le continent, mais ils sont néanmoins faibles comparés aux valeurs relevées dans d’autres régions du monde. Par exemple, pour la période 2007-2011, la part moyenne des exportations intra-régionales dans les exportations totales était de 11 % en Afrique, contre 50 % en Asie et 70 % en Europe.
L’élimination des obstacles au commerce est importante, mais elle n’aura pas les effets souhaités si elle n’est pas complétée par un effort des gouvernements pour accroître la diversité et la complexité des biens produits − processus que les économistes appellent expansion des capacités productives. Cela passe par des mesures telles qu’une modernisation des infrastructures, une amélioration des compétences de la main-d’œuvre locale, l’encouragement et la promotion de l’entreprenariat, et un accroissement de la taille des entreprises manufacturières de façon qu’elles puissent répondre aux besoins de plus vastes marchés et produire en bénéficiant de plus grandes économies d’échelle.
Au-delà des mesures à prendre pour accroître le commerce régional − et bénéficier de la croissance économique qui devrait en découler − les nations africaines doivent produire les marchandises à échanger entre elles, sinon les entreprises concurrentes étrangères combleront le vide, avertit le Rapport sur le développement économique en Afrique. Il recommande aussi que les gouvernements africains encouragent le secteur privé en rendant le crédit plus accessible et moins onéreux, et en renforçant les mécanismes de consultation entre les pouvoirs publics et le secteur privé.
Des débouchés à court terme inexploités en matière de commerce régional en Afrique existent en particulièr dans le secteur agricole. L’Afrique possède 27 % environ des terres arables dans le monde, qui pourraient servir à accroître la production agricole. Or de nombreux pays africains importent des denrées alimentaires et agricoles de pays d’autres continents. Entre 2007 et 2011, 37 pays africains étaient importateurs nets de denrées alimentaires, et 22 importateurs nets de matières brutes d’origine agricole. Mais seulement 17 % environ du commerce mondial africain de denrées alimentaires et d’animaux vivants se faisaient entre pays africains. D’après le rapport, un enjeu fondamental pour les responsables africains est de savoir comment exploiter ces possibilités pour accroître le commerce régional, en s’assurant que cela profite avant tout à l’Afrique.
Mais les meilleures perspectives à long terme − et le plus grand défi − sont d’améliorer les capacités industrielles pour produire les biens dont le commerce régional accroît généralement la demande, selon le rapport de la CNUCED. Les effets positifs d’une large expansion du commerce régional − amplement illustrés par le cas asiatique − tiennent au fait que vendre sur des marchés proches donne aux entreprises un avantage de coût en raison de la proximité, de moindres frais de transport, d’une meilleure connaissance permettant d’adapter les produits aux conditions locales et, si les marchés de consommateurs sont suffisamment importants, d’une masse critique justifiant une expansion des capacités.
Les flux commerciaux existants expliquent en partie le potentiel: les pays africains ont tendance à exporter un pourcentage plus élevé d’articles manufacturés vers d’autres africains (43 % de l’ensemble du commerce intra-africain), alors que les articles manufacturés ne représentent que 14 % des exportations totales africaines vers les marchés extérieurs.
L’enjeu est clair. L’Afrique ne représente que 1 % de la production manufacturière mondiale, et l’activité manufacturière représente 10 % environ du PIB africain, contre 35 % en Asie de l’Est et dans le Pacifique et 16 % en Amérique latine et dans les Caraïbes. Le faible niveau de l’activité manufacturière en Afrique implique que les articles manufacturés − automobiles, machines, biens électroniques − doivent être importés du reste du monde, ce qui peut être considéré comme un problème, mais aussi comme une chance potentielle. D’après le rapport, plusieurs marchés nationaux peuvent être intégrés en un vaste marché régional, le volume de clientèle devrait être suffisant pour soutenir une expansion de l’industrie dans la région.
Autre obstacle: les coûts de transport de marchandises parmi les plus élevés au monde. En Afrique centrale, transporter une tonne de marchandises entre Douala au Cameroun et N’Djamena au Tchad revient à 0,11 dollar le kilomètre, soit deux fois plus qu’en Europe occidentale (0,05 dollar) et plus de cinq fois plus qu’au Pakistan (0,02 dollar).
Pour la CNUCED, la nature des biens produits et exportés par les entreprises africaines a une grande importance pour la croissance et l’expansion du commerce intra-africain. Les pays africains produisent et exportent une gamme restreinte de marchandises, le plus souvent des produits de base tels que pétrole, gaz naturel et métaux. Pour la période 2007-2011, deux produits seulement ont représenté plus de 80 % des exportations vers d’autres pays africains de l’Algérie, de l’Angola, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Nigéria. L’absence de diversification économique et une faible base manufacturière freinent le commerce intra-régional.
Libérer le potentiel commercial du secteur privé impose de s’attaquer aux caractéristiques de la structure des entreprises africaines qui entrave le commerce régional. Par exemple, les entreprises africaines sont souvent très petites, ce qui les empêche d’opérer à l’échelle minimale nécessaire pour être compétitives. La taille moyenne d’une entreprise manufacturière en Afrique subsaharienne est de 47 employés, contre 171 en Malaisie, 195 au Viet Nam, 393 en Thaïlande et 977 en Chine. On relève aussi la faiblesse des liens entre petites et grandes entreprises en Afrique, qui rend difficile pour les premières de profiter des compétences et des capacités d’innovation des secondes, avec de lourdes conséquences pour leur croissance. D’autres problèmes structurels concernent le pourcentage élevé d’entreprises relevant du secteur informel, le faible niveau de compétitivité des exportations et un manque de capacités d’innovation commerciale.
Enfin, il est fondamental pour les pays africains de préserver la paix et la stabilité en tant que préalables pour pouvoir renforcer le développement du secteur privé et dynamiser le commerce intra-africain. De récentes données ont montré que le conflit politique en Côte d’Ivoire fin des années 1990, avait réduit le commerce intracommunautaire au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) d’environ 60 % entre 1999 et 2007.
Le rapport - http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/aldcafrica2013_en.pdf