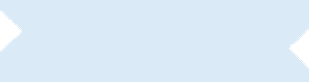Communiqué de presse
Pour l'utilisation des médias d'information - Ce n'est pas un document officiel
UNCTAD/PRESS/IN/2019/2/Rev.1 Faits et Chiffres
Le développement économique en Afrique : « Made in Africa » − Les règles d’origine, un tremplin pour le commerce intra-africain
Geneva, Suisse, 26 juin 2019
Il ressort du Rapport 2019 sur le développement économique en Afrique que les règles d’origine − qui permettent de déterminer la nationalité d’un produit − pourraient être la clef du succès ou de l’échec de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), entrée en vigueur en mai. Selon le rapport, les règles pourraient changer la donne pour le continent si elles sont simples, souples, transparentes, favorables aux entreprises et prévisibles.
Situation du commerce régional en Afrique
- La valeur totale des exportations de l’Afrique vers le reste du monde s’est élevée en moyenne à 760 milliards de dollars des États-Unis en prix courants entre 2015 et 2017, contre 481 milliards pour l’Océanie, 4 109 milliards pour l’Europe, 5 140 milliards pour les États-Unis et 6 801 milliards pour l’Asie.
- Pendant la période 2000-2017, la part des exportations de l’Afrique vers le reste du monde était comprise entre 80 % et 90 % du total de ses exportations. La seule région qui dépende davantage des exportations vers le reste du monde est l’Océanie.
- En 2017, les exportations intra-africaines ont représenté 16.6 % des exportations totales, contre 68.1 % pour les exportations intra-européennes, 59.4 % pour les exportations intra-asiatiques, 55.0 % pour les exportations intra-américaines et 7.0 % pour les exportations intra-océaniques.
- Les échanges intra-africains, qui correspondent à la moyenne des exportations et importations intra-africaines, se sont élevés à environ 15,2 % du total des exportations de l’Afrique pendant la période 2015-2017, alors qu’en Amérique, en Asie, en Europe et en Océanie, les échanges intracontinentaux représentaient respectivement 47 %, 61 %, 67 % et 7 % du total des échanges.
- Depuis 2008, l’Afrique et l’Asie sont les seules régions au sein desquelles les échanges augmentent.
- En 2016, les échanges intrarégionaux des communautés économiques régionales ont été les plus élevés dans la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) (34,7 milliards de dollars), suivie de la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD) (18,7 milliards de dollars), de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) (11,4 milliards), du Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA) (10,7 milliards), de l’Union du Maghreb arabe (UMA) (4,2 milliards), de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) (3,1 milliards), de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) (2,5 milliards) et de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) (0,8 milliard).
- En ce qui concerne la part des échanges intrarégionaux des communautés économiques régionales dans le commerce total en Afrique, en 2016, les niveaux d’intégration étaient de 84,9 % dans la SADC, de 59,5 % dans la COMESA, de 58,4 % dans la CEN-SAD, de 56,7 % dans la CEDEAO, de 51,8 % dans l’UMA, de 49,0 % dans l’IGAD, de 48,3 % dans la CAE et de 17,7 % dans la CEEAC.
- Pendant la période 2015-2017, les 10 premiers exportateurs intra-africains étaient le Swaziland (70,6 %), la Namibie (52,9 %), le Zimbabwe (51,6 %), l’Ouganda (51,4 %), le Togo (51,1 %), le Sénégal (45,6 %), Djibouti (41,9 %), le Lesotho (39,9 %), le Kenya (39,3 %) et le Malawi (38,3 %).
- Les 10 pays ayant la part la plus faible des exportations intra-africaines étaient le Tchad (0,2 %), la Guinée (1,6 %), l’Érythrée (2,3 %), la Guinée équatoriale (3,5 %), Cabo Verde (3,6 %), l’Angola (3,9 %), la Libye (4,5 %), la Guinée Bissau (4,7 %), le Libéria (5,1 %) et l’Algérie (5,5 %).
État de la facilitation du commerce
- En moyenne, les taux de droits appliqués aux membres des communautés économiques intrarégionales s’établissent à 7,4 % dans la CEN-SAD, 5,6 % dans la CEDEAO, 3,8 % dans la SADC, 2,6 % dans l’UMA, 1,89 % dans le COMESA, 1,86 % dans la CEEAC, 1,80 % dans l’IGAD et zéro dans la CAE.
- L’Afrique subsaharienne est la région où le coût de l’exportation est le plus élevé. Le coût de l’importation y est également plus élevé que dans les autres régions, à l’exception de l’Amérique latine et des Caraïbes, si l’on tient compte des formalités à accomplir aux frontières, et de l’Asie du Sud, si l’on tient compte des exigences à respecter en matière de documentation.
- Pendant la période 2010-2013, dans 23 pays en développement (dont 13 pays d’Afrique) et PMA, 35 % des mesures non tarifaires les plus strictes appliquées par les pays partenaires aux exportations manufacturières portaient sur les règles d’origine et la documentation connexe.
- Les plaintes les plus fréquentes enregistrées par le Mécanisme de signalement, de surveillance et d’élimination des barrières non tarifaires de l’Accord de libre-échange tripartite ont trait aux règles d’origine (11 % des plaintes déposées).
Règles d’origine
- On a estimé, avant les réformes du Système des préférences généralisées (SPG) de 2011, que les règles d’origine plus souples prévues par la loi des États-Unis d’Amérique sur la croissance et les perspectives économiques de l’Afrique (African Growth and Opportunity Act) − qui exige une seule transformation − stimulent davantage les exportations des PMA d’Afrique que les règles d’origine plus restrictives prévues par l’initiative Tout sauf les armes de l’Union européenne.
- À partir d’un modèle gravitationnel appliqué à 155 pays et à une centaine d’accords commerciaux préférentiels, Estevadeordal et Suominen (2005) concluent que : i) les accords commerciaux préférentiels qui prévoient des règles d’origine restrictives ont tendance à réduire les flux commerciaux globaux ; ii) les régimes autorisant une certaine souplesse dans la mise en œuvre des règles d’origine applicables à des produits particuliers facilitent les échanges ; iii) les règles d’origine restrictives applicables aux biens finals stimulent les échanges de biens intermédiaires ; et iv) les effets négatifs des règles d’origine strictes applicables à des produits particuliers s’estompent avec le temps.
- Les valeurs du commerce intra-africain (tant pour les importations que pour les exportations) des 20 produits ayant les marges préférentielles les plus élevées étaient relativement faibles, à l’exception des produits du tabac, de la bière et des spiritueux, des T-shirts tricotés, du vin et des costumes et pantalons pour femmes, ce qui s’explique en partie par la difficulté de se procurer ces produits sur le continent.
- Selon François et consorts (2006), les exportateurs commencent à demander à bénéficier des préférences lorsque les marges préférentielles sont comprises entre 4,0 % et 4,5 %. Sur les 20 produits dont les valeurs d’exportation sont les plus fortes en Afrique, 11 produits présentent des marges préférentielles de plus de 4,5 %, notamment cinq des six produits les plus exportés, à savoir les gaz de pétrole, l’or, le pétrole raffiné, les diamants et les automobiles.
- La part des importations en provenance d’Afrique qui sont admises à bénéficier et tirent parti dans les faits d’un traitement préférentiel extérieur varie considérablement d’un partenaire commercial à l’autre ; c’est au Chili, en République de Corée et aux États-Unis qu’elle est la plus élevée.
- En ce qui concerne l’utilisation des régimes préférentiels extérieurs par les pays d’Afrique, certains pays sont, dans une large mesure, incapables d’utiliser le traitement préférentiel dont bénéficient leurs exportations vers leurs partenaires, à savoir le Bénin (taux de sous-utilisation de 95,4 %), le Burkina Faso (100 %), Djibouti (96,5 %), la Guinée équatoriale (93,2 %), la Guinée (100 %), la Guinée-Bissau (100 %), le Libéria (100 %), la Libye (100 %) le Mali (99,6 %), la République centrafricaine (100 %), la République-Unie de Tanzanie (94 %), les Seychelles (100 %), la Sierra Leone (100 %), la Somalie (98,9 %) et le Togo (100 %),
- Les pays suivants affichent de faibles taux de sous-utilisation : Botswana (1,1 %), Cabo Verde (3,6 %), Côte d’Ivoire (2 %), Comores (4,3 %), Ghana (2,3 %), Kenya (4,5 %), Lesotho (1,7 %), Madagascar (4,9 %), Mauritanie (3,1 %) et Tchad (0,1 %).
- En 2016, les montants des préférences non utilisées sont les plus élevés pour les produits minéraux (2,3 milliards de dollars), suivis des matières précieuses (1,4 milliard de dollars) et des produits végétaux (0,6 milliard de dollars). En outre, les instruments de précision, les produits chimiques, le bois et les cuirs et peaux étaient, par ordre décroissant, les produits enregistrant le taux de sous-utilisation le plus haut.
Thé
- Le Kenya compte parmi les pays qui ont le mieux réussi à intégrer les petits exploitants agricoles dans la chaîne de valeur du thé ; il s’est pour cela employé à accroître leur participation à la gestion des étapes de transformation et de commercialisation (FAO, 2014). Les petits exploitants assurent plus de 70 % de la production nationale de thé, avec un demi-million de personnes qui tirent leur subsistance de cette culture.
- Pendant la période 2015-2017, l’Afrique a représenté plus de 20 % des exportations mondiales de thé et 12 % des importations. Le Kenya est de loin le champion de l’Afrique dans ce domaine ; avec une part de marché d’environ 17 % au cours de cette période, il est le troisième exportateur mondial de thé. Entre 2015 et 2017, les importations de thé en Afrique étaient d’origine chinoise et intra-africaine à hauteur, respectivement, de 43 % environ et de 40 % ; le reste provenait principalement de l’Inde et de Sri Lanka.
- Globalement, environ 25 % des exportations de thé du continent sont destinées au marché intra-africain.
Cacao
- Bien que les exportations africaines de cacao et de produits connexes vers le reste du monde soient de très loin supérieures aux exportations intra-africaines, s’établissant respectivement à 7,8 milliards de dollars par an en moyenne et 170 millions de dollars pour la période 2015-2017, les produits échangés en Afrique incorporent avant tout une plus forte valeur ajoutée, le chocolat représentant près de 60 % du total.
- La participation de l’Afrique à la chaîne de valeur du cacao peut se caractériser par une dichotomie. D’un côté, la plupart des pays producteurs de cacao fournissent, principalement aux pays développés, des matières premières et des produits intermédiaires semi-transformés (participation en aval) à faible valeur ajoutée. D’un autre côté, quelques centres de fabrication − par exemple, l’Égypte et l’Afrique du Sud − fournissent des produits finis à base de chocolat sur leurs marchés intérieur et sous-régional, mais s’approvisionnent principalement en biens intermédiaires (participation en amont) en dehors du continent.
- Le secteur du cacao-chocolat reste très protégé en Afrique, avec des taux de droits médians au titre de la nation la plus favorisée allant d’environ 5 % à 25 %, selon la position des produits dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Il existe sans conteste des crêtes tarifaires − taux tarifaires de 15 % ou plus − et une progressivité des droits.
Coton
- Soixante-dix pourcent des exportations de coton en provenance d’Afrique sont des biens intermédiaires non transformés à faible valeur ajoutée, comme les fibres de coton (cardées ou non) ; seulement 12 % sont des fils et 18 % des tissus de coton. À l’inverse, les importations africaines de coton comptent environ 12 % de biens intermédiaires non transformés, 16 % de fils et 72 % de tissus de coton.
- Les échanges intra-africains représentent seulement 15 % des exportations de coton et 12 % des importations en Afrique ainsi que 10 % des exportations et 17 % des importations de vêtements du continent.
- Pendant la période 2001-2017, les PMA ont bénéficié d’un accès en franchise de droits et sans contingent au marché de l’Union européenne dans le cadre de l’initiative Tout sauf les armes. Depuis la réforme, en 2011, du Système généralisé de préférences, les nouvelles règles d’origine applicables aux textiles et vêtements provenant des PMA n’exigent plus une double transformation, mais une transformation simple. Cette réforme s’est accompagnée d’une augmentation sensible de la part de marché des PMA dans l’Union européenne, ainsi que d’une amélioration du taux d’utilisation des préférences.
- Des données empiriques laissent penser que même dans les pays où l’industrie du vêtement est assez dynamique, comme Maurice, les petites et moyennes entreprises (PME) ont souvent plus de mal que les grandes entreprises à rester compétitives lorsqu’elles doivent se conformer à des exigences de double transformation.
- Si l’on envisage une approche fondée sur la double transformation, le cumul total pourrait être essentiel pour s’assurer que les préférences qui s’appliquent à la zone de libre-échange continentale restent intéressantes du point de vue commercial et n’entravent pas excessivement les stratégies des entreprises africaines.
Boissons
- La dépendance à l’égard des importations intra-africaines est plus forte pour la bière (44 %) et les boissons non alcoolisées (39 %) que pour les spiritueux (14 %). Les principaux importateurs de la région sont la Namibie, le Mozambique, l’Ouganda, le Lesotho, la République-Unie de Tanzanie, le Ghana, le Rwanda, Maurice, le Mali, le Bénin et la Tunisie.
- Dans la région, les droits de douane applicables aux exportations de boissons sont élevés, étant donné que la plupart des pays d’Afrique échangent entre eux aux taux de la nation la plus favorisée. Pendant la période 2014-2016, les pays d’Afrique subsaharienne ont enregistré des taux médians compris entre 20 % et 30 %, en fonction de leur position tarifaire.
Secteur automobile
- Le secteur automobile africain reste très largement tourné vers l’extérieur, notamment pour ce qui est des voitures particulières, pour lesquelles le marché régional représentait moins de 10 % des exportations et 2 % des importations.